


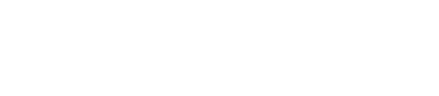
L’effondrement du Big Bang
Redécouvrir l’Univers
Alex Williams & John Hartnett
ARTICLES
Orage sur le Big Bang
Pour
la
première
fois,
avec
une
parution
dans
le
New
Scientist
et
une
signature
collective
sur
un
site
Internet,
une
opposition
organisée
s’est
élevée
contre
la
théorie
du
Big
Bang.
Paradoxalement,
c’est
au
moment
où
cette
thèse
triomphe
dans
le
grand
public,
que
des
spécialistes
hautement
qualifiés
s’entendent
pour
dénoncer
les
erreurs
et
les
limites
de
cette
«
théorie
du
ciel
»
et
surtout
les
obstacles
divers
qui
dissuadent
les
chercheurs
de
travailler
sur
des
modèles
alternatifs.
Par Dominique Tassot, Ph.D U n éclair annonciateur vient de traverser le ciel de l’astrophysique : la théorie du Big Bang est attaquée avec force et d’une manière inédite dans l’histoire des sciences. Alors que cette théorie a trouvé sa place dans les manuels, les revues à grand tirage, et même les catéchismes, un groupe de 34 scientifiques de haut niveau, spécialistes d’une discipline concernée, ont signé une déclaration collective récusant cette théorie qui, on s’en rend compte désormais, n’avait jamais fait l’unanimité. Cette déclaration , publiée dans le New Scientist n° 182 du 22 mai 2004, peut être signée sur Internet par tous les scientifiques qui le souhaitent : il suffit de se relier à l’adresse Internet cosmologystatement.org et de donner son nom et ses qualifications. A l’heure où nous écrivons, 181 chercheurs et universitaires et 50 « autres signa- taires » (qui ne sont pas des professionnels en poste) se sont joints aux 34 mousquetaires. Il s’agit ici d’un nombre considérable d’opposants. En effet, la théorie du Big Bang utilise un formalisme mathématique complexe dans lequel bien peu ont envie de s’aventurer. Cette première barrière (que l’on retrouve à un degré moindre, avec la théorie de la relativité) suffit déjà à dissuader la plupart de contester une thèse bien établie depuis plus d’un demi- siècle et qui, il faut le dire, n’a guère de retombées pratiques, si ce n’est pour ceux qui en vivent. La communauté des scientifiques spécialisés, suffisamment à l’aise dans les équations du Big Bang pour se permettre un jugement, est réduite : peut- être 200 pour la terre entière. Or, sur les seuls 34, 10 nations sont représentées (Allemagne, Brésil, Canada, Etats- Unis, France, Grande-Bretagne, Inde, Italie, Pologne et Russie) avec leurs institutions les plus réputées : Max-Planck-Institute für Astrophysik, Institut astronomique de Saint Pétersbourg, Université de Cambridge, Collège de France, Université Jagiellon, Istituto Nazionale di Astrofisica, California Institute of Technology, Laurence Livermore National Laboratory, Los Alamos National Laboratory, Jet Propulsion Laboratory, etc. Les trois Français sont Jean-Claude Pecker (Collège de France), Jacques Moret-Bailly (Université de Dijon) et Georges Paturel (Observatoire de Lyon) auxquels il faut ajouter Jayant Narlikar, professeur émérite à l’Université de Calcutta et au Collège de France. Il ne s’agit donc pas ici d’une contestation marginale destinée à s’éteindre avec la mort du dernier récalcitrant, comme ce fut le cas du débat sur la génération spontanée au XIX ème siècle. Il s’agit plutôt d’une fronde menée par des spécialistes hautement qualifiés, dont l’opposition, pour certains, dure depuis des dizaines d’années. Ainsi Halton Arp, découvreur des « ponts de Arp » ne peut évidemment accepter l’idée que divergent (et à des vitesses fantastiques) des galaxies entre lesquelles il a observé des ponts de matière en forme de filaments. De là, le ton tout à fait inhabituel de cette « Lettre ouverte à la communauté scientifi- que » : « Le Big Bang repose aujourd’hui sur un nombre croissant d’entités hypothétiques, de choses que nous n’avons jamais observées : l’expansion (de l’univers), la matière noire et l’énergie noire en sont les exemples les plus marquants. Sans eux, il y aurait une contradiction fatale entre les observations faites par les astronomes et les prédictions de la théorie du Big Bang. Dans aucun autre domaine de la physique ce continuel recours à de nouveaux objets hypothétiques ne serait accepté comme moyen de faire la jonction entre la théorie et l’observation. Il soulèverait, pour le moins, de sérieuses questions sur la validité de la théorie sous-jacente. » La théorie est accusée d’empiler des hypothèses artificielles sans aucune valeur prédictive, valeur qui fait pourtant la justesse d’une théorie : « En outre, la théorie du Big Bang ne peut se prévaloir d’aucune prédiction quantitative ultérieurement confirmée par l’observation. Les succès claironnés par les partisans de la théorie consistent en son aptitude à expliquer rétroactivement les observations avec un déballage sans cesse croissant de paramètres accommodants, exactement comme l’ancienne cosmologie géocentriste de Ptolémée avait besoin d’empiler les épicycles. » Or il existe des modèles alternatifs, comme la cosmologie du plasma et l’univers stationnaire, qui eux ont prédit des phénomènes observés ultérieurement. C’est donc au nom de la démarche scientifique elle-même que les contestataires mettent en cause le fonctionnement du milieu de la recherche : « Les partisans du Big Bang peuvent rétorquer que ces théories n’expliquent pas toutes les observations cosmologiques. Mais ceci ne saurait surprendre puisque leur élaboration a été sévèrement entravée par un manque complet de financement. En fait, ces questions et les solutions alternatives ne peuvent pas, même maintenant, être librement discutées et examinées. Dans la plupart des grandes conférences l’échange ouvert d’idées fait défaut. Alors que Richard Feynman a pu dire que « la science est la culture du doute », en cosmologie aujourd’hui le doute et le désaccord ne sont pas tolérés et les jeunes savants apprennent à garder le silence s’ils ont quelque chose de négatif à dire sur le modèle standard du Big Bang. Ceux qui doutent du Big Bang craignent qu’en le disant cela ne leur coûte leur financement. Les observations elles-mêmes sont interprétées au travers de ce filtre tendancieux, jugées vraies ou fausses selon qu’elles s’accordent ou non avec le Big Bang. Ainsi des données discordantes sur le décalage vers le rouge, l’abondance de lithium et d’hélium, la répartition des galaxies, entre autres sujets, sont ignorées ou ridiculisées. Cela traduit un état d’esprit de plus en plus dogmatique, étranger à l’esprit de la libre recherche scientifique. » On a toujours tendance à se représenter le savant comme un Lavoisier ou un Ampère, libre d’orienter ses recherches à son goût. Or, aujourd’hui, presque tous les chercheurs sont des salariés qui dépendent, pour leurs choix, de comités de financement. Et la prise des décisions en comité va toujours vers un consensus mou. Comme les quelques comités concernés par l’astrophysique sont aujourd’hui dominés par les partisans du Big Bang, il semble difficile de renverser la situation. Or, il existe une dissymétrie manifeste, en sciences, entre les partisans de la théorie établie et leurs opposants. Le « partisan » de la théorie du Big Bang ne s’est généralement pas imposé d’en faire un examen critique : il a pris l’habitude de l’enseigner et d’interpréter les faits à sa lumière. Il se contente souvent de lire rapidement les rares articles contestataires publiés, en se disant que le temps fera son œuvre et que d’autres répondront aux objections. L’opposant, lui, est généralement un jeune chercheur qui tombe sur un « fait polémique » selon la formule de Bachelard : ainsi les ponts de Arp, dont nous avons parlé, ou l’abondance de l’hélium. Pour Bachelard, le " fait polémique " est de ceux qui font avancer la science : en mettant en cause les idées admises, il oblige à les retravailler ou à en changer. Ceci est la théorie de la science. Mais la pratique du milieu scientifique, comme de toute société, en diffère bien souvent : la tentation est grande, pour le chercheur, de plaire au patron, d’éviter les ennuis et de contourner l’épine entrevue. Tout savant ne se sent pas vocation au martyre. Tout chercheur n’est pas un Bernard Palissy qui, selon la légende, n’hésita pas à brûler les meubles de sa maison pour mettre au point les « glaçures » des céramiques. Dans ce contexte, la fronde de nos 34 mousquetaires contre le Big Bang doit être saluée comme un signal majeur. Comme en politique, il est des vérités qu’on ne peut taire ou esquiver indéfiniment. La force de la vérité vient qu’elle détient en elle-même les moyens de s’imposer à la conscience droite, comme à l’intelligence qui ne se laisse pas détourner de sa vocation. Dans cette crise du Big Bang, on sent poindre un retour du sens commun et un effort collectif pour soulever la chape de théories qui étouffent la recherche scientifique au lieu de la stimuler, qui la brident au lieu de l’éclairer. Une hirondelle ne fait pas le printemps, mais on peut voir ici le signal indubitable d’un virage majeur qui, nous avons tous les éléments pour l’affirmer, ne se limitera pas à la cosmologie. C’est aussi un signal –espérons qu’il sera perçu - pour les théologiens qui ont cru pouvoir esquiver tout risque intellectuel et toute nouvelle « affaire Galilée », en subordonnant leur pensée aux affirmations de la science. D’une part, toute œuvre de l’esprit est un périple qui, quelque part, croise toujours les vagues de la haute mer ; d’autre part la Bible nous dit à de multiples reprises : « Seuls ceux qui croient (donc ceux qui ajoutent foi aux affirmations de la Parole révélée) ne seront pas confondus (n’auront pas à rougir de leurs actes). » Source : Le Cep n°31. 1 er trimestre 2005.
A propos de Dominique Tassot

Dominique
Tassot
est
ingénieur
civil
des
Mines
(Paris
1967-1970),
docteur
en
Philosophie
(Paris-Sorbonne
1994),
ayant
soutenu
une
thèse
de
philosophie
sur
la
dialectique
de
la
science
et
de
la
Révélation
(De
Galilée
au
Père
Lagrange),
et
ancien
directeur
R&D
du
groupe
pharmaceutique
Labo'Life.
Dominique
Tassot
s'est
passionné
pour
les
rapports
complexes
qu'entretiennent
la
science
et
la
foi.
Il
est
le
président
du
Centre
d'Etudes
et
de
Prospective
sur
la
science
(CEP)
dont
il
dirige
la
revue
Le
Cep
.
Il
a
publié
plusieurs
ouvrages
qui
jettent
une
vive
lumière
sur
la
justesse
et
la
pertinence
de
l’Ecriture
dans
son
rapport
à
la
science,
dont
La
revanche
du
lièvre
chez
Via
Romana
en
2013
(173
pages),
L'évolution
en
100
questions-réponses
,
publié
aussi
chez
Via
Romana
(2021,
306
pages)
et
La
Bible
au
risque
de
la
science.
De
Galilée
au
P.
Lagrange
chez
François-Xavier
de
Guibert
(1998,
366
pages).














